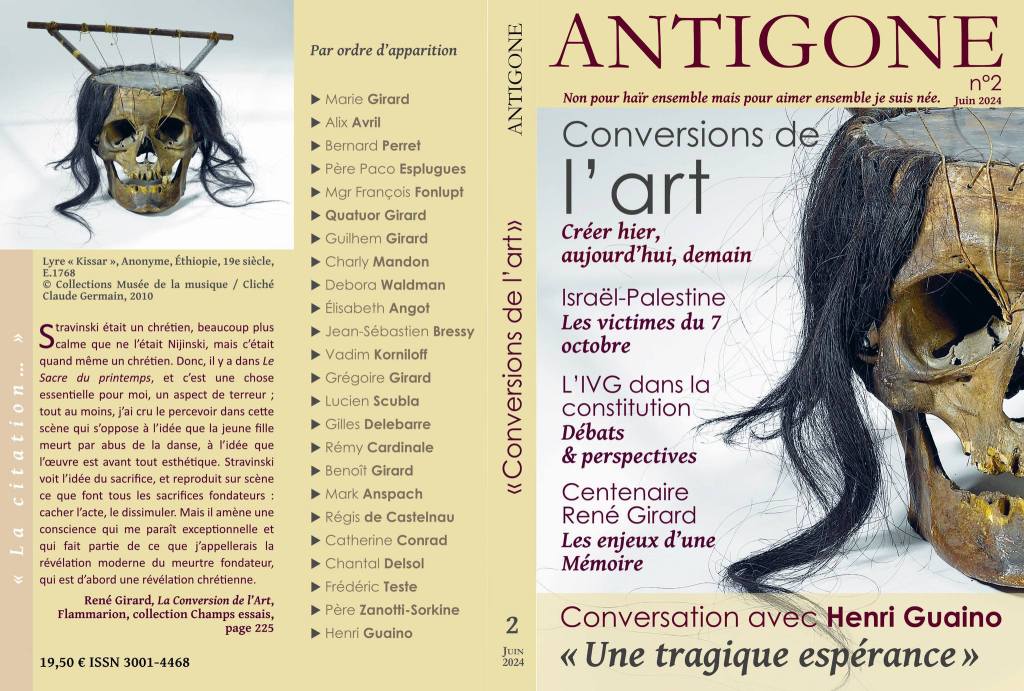
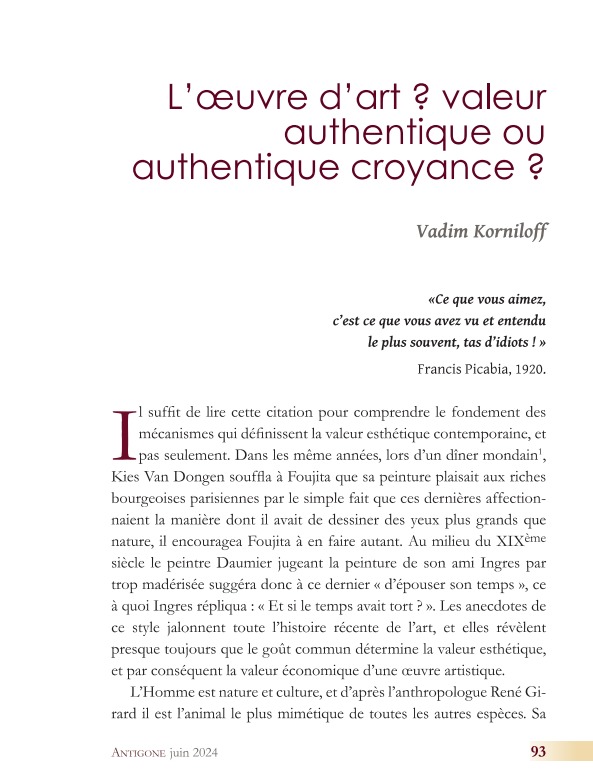




Pour commander la revue : https://sajrenegirard.fr/antigone/
.
L’article complet :
« Ce que vous aimez, c’est ce que vous avez vu et entendu le plus souvent, tas d’idiots !« , Francis Picabia, 1920.
Il suffit de lire cette citation pour comprendre le fondement des mécanismes qui définissent la valeur esthétique contemporaine, et pas seulement. Dans les même années, lors d’un dîner mondain(1), Kies Van Dongen souffla à Foujita que sa peinture plaisait aux riches bourgeoises parisiennes par le simple fait que ces dernières affectionnaient la manière dont il avait de dessiner des yeux plus grands que nature, il encouragea Foujita à en faire autant. Au milieu du 19ème siècle le peintre Daumier jugeant la peinture de son ami Ingres par trop madérisée suggéra donc à ce dernier « d’épouser son temps« , ce à quoi Ingres répliqua : « Et si le temps avait tort? ». Les anecdotes de ce style jalonnent toute l’histoire récente de l’art, et elles révèlent presque toujours que le goût commun détermine la valeur esthétique, et par conséquent la valeur économique d’une oeuvre artistique.
L’Homme est nature et culture, et d’après l’anthropologue René Girard il est l’animal le plus mimétique de toutes les autres espèces. Sa construction mimétique est totale : il regarde, observe et imite. Cette propension propre à l’Homme ne se limite pas aux simples fonctions vitales, mais également à ses désirs. Le désir mimétique, ainsi nommé par René Girard, est en partie le chef d’orchestre de toutes sociétés humaines, ainsi que le fondement même de ce qui fait sens, une culture. La culture se construit donc naturellement par des constructions successives d’imitations. Toutes les grandes périodes artistiques de l’histoire de l’art moderne (entre autres) : les Nabis, les expressionnistes, les surréalistes, les cubistes, etc., nous montrent à quel point la théorie de Girard est applicable au domaine de l’art. En effet, la valeur esthétique d’une oeuvre d’art ou plus simplement son devenir « art », semble suivre le même processus que la construction sociale des individus (l’individuation). L’imitation part du principe qu’un original existe, et lorsque l’on essaye de remonter à l’origine du modèle, celui-ci se révèle être dans sa grande majorité le produit d’un « accident » et non pas d’un résultat logique de la pensée, ou simplement d’une intention. J’entends par intention la finalité entendue d’un objet ou d’un concept dès son origine. Picasso bénéficia ainsi de l’intérêt de la science anthropologique de son époque pour les objets de culte africain, lesquels sortis de leur contexte et fonction premiers, c’est à dire être des objets de culte et de rite, deviennent alors connus du monde occidental. Picasso, non pas sans un talent technique et/ou artistique certain, commença alors à imiter ces reliques cultuelles, à les copier, pour finalement les intégrer dans sa peinture. Le cubisme résulte lui aussi d’une imitation, celui des effets de l’innovation technique de la photographie et du cinéma. Le « nu descendant l’escalier » de Marcel Duchamp, oeuvre cubiste emblématique d’alors pour son titre(!), est une décomposition visuelle d’une action restituée cinématographiquement(2). Ce qui est révélé par le récit historique romantique(3) comme étant d’authentiques révolutions artistiques semble être en définitif des produits d’imitations. Aussi, l’évolution des mœurs sociales de toutes les époques impacte-elle les artistes et leur permet-elle ainsi d’imiter ce que l’on n’imitait pas jusqu’à présent. Cependant, il est évident qu’à la source de toute série d’imitation il existe un modèle originel que l’on pourrait alors qualifier de valeur authentique. Celle-ci est à mon sens incarnée par la nature, celle qui nous a précédés et qui nous entoure. Si l’on admet qu’il existe un acte artistique totalement pur et vierge, dans le sens de celui qui n’imiterait rien, alors les toiles d’araignée, la ruche des abeilles, etc., toutes ces réalisations animales totalement instinctives pourraient être classées dans le domaine d’un art dont la valeur (ou nature) est objectivement authentique, car dénuées de tout calcul esthétique ou/et économique. L’innovation artistique perpétuelle de l’Homme réside dans son imitation de la nature. L’oeuvre d’art est donc une construction exclusivement culturelle (et donc sociale), et le fameux ready-made de Marcel Duchamp en est la démonstration la plus brillante à ce jour. En effet, désigner n’importe quel objet du quotidien à peine modifié tel que « La Fontaine »(1917), le ready-made emblématique par excellence qui consistait en un urinoir retourné, démontre ainsi que sans le consentement mutuel des spectateurs (« regardeurs » dixit Duchamp), c’est à dire sans leur (notre) croyance commune, la sacralisation de n’importe quel objet en œuvre d’art ne peut par conséquent exister.
Marcel Duchamp ne retourne pas seulement un urinoir mais la réalité dans son entier, du moins la succession des simulacres qui la composent.
La valeur esthétique (occidentale) est depuis le début de l’ère capitaliste intrinsèquement liée à la valeur économique, voire marchande. Celle-ci est planifiée par des mécanismes artificiels relevant de la psychanalyse dont les fondements se réfèrent en partie à la théorie de René Girard, c’est à dire le « désir mimétique ». Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, est considéré comme le père de la propagande politique et industrielle, il sera l’un des premiers à comprendre que les travaux de son oncle, au-delà d’expliquer les fondements de la psychanalyse moderne, peuvent également être utilisés à des fins commerciales. On prête à Bernays l’exploit d’avoir sauvé de la faillite le cigarettier Philip Morris lors de la crise de 1929 en transformant considérablement les mœurs de son époque. En effet, les femmes ne fumaient pas, et la seule solution à court terme pour la firme Philip Morris était alors de trouver de nouveaux fumeurs. Bernays suscita alors le désir féminin en faisant fumer pour la première fois à l’écran les stars féminines du moment (le cinéma était alors le divertissement le plus populaire de ces années-là). Cette pratique bien connue des publicitaires, relève bien plus du neuro-marketing que de la simple réclame. C’est donc en associant un objet ordinaire à ce que l’on pourrait appeler un signe iconique (ici une star connue et reconnue) que cet objet va puiser toute sa légitimité et par conséquent sa valeur. Ces signes iconiques servent alors de leviers de valorisation à n’importe quel autre objet ou concept (comme le fait de fumer). Cette pratique est plus connue en marketing sous le nom de la polarisation des affects collectifs ou communs sur un objet.
Andy Warhol, publicitaire de son état, compris très vite l’importance de ce procédé de valorisation et à l’instar de Bernays, il recycla l’image de stars internationales (Marylin Monroe, James Dean, etc.) ainsi que des objets de marques populaires (Campbell’s soup, tampons à récurer de la marque Brillo, etc.) directement dans la réalisation de ses œuvres. Les signes iconiques ainsi utilisés permettent, au-delà de tout système d’appréciation relevant de celui des beaux-arts (le curseur du passé?), de remporter instantanément l’adhésion du plus grand nombre. Cependant l’adhésion n’est pas synonyme de reconnaissance, condition sine qua non du devenir « oeuvre d’art » de tout objet ayant pour fonction cette finalité. Le philosophe et critique d’art Arthur Danto a été l’un des premiers à pressentir le bouleversement de tous les systèmes d’appréciation du domaine de l’art. Au début des années 1960, Andy Warhol proposait dans l’une de ses premières expositions à New-York, une oeuvre d’art qui consistait en un entassement de boîtes de tampons à récurer de la marque Brillo. Arthur Danto en déduisit alors que le statut d’oeuvre d’art que l’on pouvait accorder à cet entassement qui se placait donc en dehors de tous critères d’appréciations fondés du domaine des beaux-arts, tenait simplement au fait qu’il soit exposé dans une galerie d’art new-yorkaise connue et reconnue(4). Ainsi Andy Warhol bénéficie ici d’une part d’un levier d’adhésion générale et donc celui d’une certaine forme de valorisation esthétique par le fait qu’il ait recyclé la marque « iconique » Brillo. D’autre part il bénéficie aussi d’un support de valorisation économique par le simple fait qu’il ait exposé ce même « objet » dans un lieu connu et reconnu comme étant un lieu d’art, une galerie d’art.
Dans la Grèce antique on départageait ainsi la raison à la pulsion : la première est ce qui provient de la tête, « l’âme du haut », et la seconde du ventre, « l’âme du bas ». L’art des fous (ou l’art outsider(5)), initié au milieu du 19ème siècle par le docteur Joseph Guislain à l’hôpital psychiatrique de Gand en Belgique (le premier par ailleurs à considérer les fous comme des patients), est probablement l’activité artistique dont la démarche serait au fond la plus authentique. En effet aucune prétention culturelle de devenir « oeuvre art » ou encore d’ambition économique ne motive l’art des fous, puisque celui-ci résulte de l’effet de « l’âme du bas » et non de la raison. Cependant, même si l’on admet que l’activité manuelle de ces patients est une forme de thérapie dépourvue de toutes ambitions, du moins celles qui aboutissent au destin marchand de notre système (occidental) de valeur, cette production manuelle peut tout de même faire son apparition dans les mécanismes de valorisations cités plus haut. Le produit de l’activité manuelle humaine, en dehors de toutes fonctions prédéterminées utiles à son confort vital, donc celui par exemple ayant une valeur thérapeutique ou spirituelle voire religieuse (Les édifices religieux), peut être nommé oeuvre d’art uniquement dans le cadre d’une politique culturelle bien définie, et par conséquent bien d’une décision fondée sur une croyance collective.
Le questionnement sur la valeur objective de l’art est aujourd’hui incarné par le travail incessant de recherche et de démonstrations empiriques qu’est l’Art contemporain. Ce dernier est la réflexion poussée à son paroxysme autour de la question de la valeur authentique de l’art ainsi que celle de l’existence objective de l’oeuvre d’art. L’Art contemporain, dont le cynisme fusionne souvent avec l’imposture donc une certaine forme d’incroyance, est probablement l’aboutissement de cette réflexion sur la question de la valorisation conceptuelle d’un « objet » en oeuvre d’art, et donc vraisemblablement le point final du récit romantique (récent) de l’art. L’art contemporain vient donc clore une histoire, non pas celle de la mémoire collective incarnée par ce que l’on peut nommer notre patrimoine, celui de notre passé voire de notre propre existence, mais celui de l’histoire romantique récente de l’art ainsi que celles de ses protagonistes : artistes, marchands, collectionneurs, etc.. Ainsi les détracteurs de l’art contemporain, au-delà de leur indignation légitime face à l’ignorance de la participation active de certains artistes de l’art contemporain à ce processus de fin de cette histoire romantique de l’art, sont soumis le plus souvent, à mon sens, à leurs propres jugements subjectifs créés par tous les mécanismes cités plus haut. Je consens naturellement que bon nombre de ces derniers expriment simplement leur rejet à l’intellectualisation forcenée des préceptes de l’art contemporain au dépend de ce que le destin de l’art était jusqu’à récemment encore : le beau(6), l’émotion, le sensible, etc.
Déplorer ou se réjouir est je pense la seule alternative affective que doit susciter la fin du récit romantique de l’histoire récente de l’art. Car cette finitude est au fond la suite logique de celle de l’histoire de l’art académique et donc celle aussi de l’apparition du bouleversement intellectuel et esthétique que fut l’art moderne. Ne pas reconnaître la légitimité de l’art contemporain revient à mon sens à ne pas croire au récit romantique de l’art, et donc de croire en une valeur authentique autre que celle provenant de la nature. Si une telle valeur existait, seul le domaine de la croyance nous permettrait de la comprendre mais surtout de l’accepter. Par conséquent la valeur authentique dans le domaine de l’art n’est, à mon sens, rien de plus qu’une authentique croyance…
Nota Bene :
Je ne voulais pas exprimer certains aspects des querelles contemporaines de l’art : celles qui opposent cette transformation de l’aspect historique de l’art à une conquête exclusivement économique des Etats-Unis sur l’Europe. Car ce dénouement est plus la conséquence, à mon sens, d’un abandon culturel de la propre culture européenne de l’Europe que de celui de la colonisation économique et donc culturelle américaine. La force d’une culture se mesure à sa propre résistance face à une autre culture, et tout m’indique que le récit romantique(3) de la fin de l’histoire de l’art, et donc en partie européenne, est le résultat de sa propre suite historique logique, celle de son autodestruction.
Vadim Korniloff
(1) Foujita vol.2 de Sylvie Buisson, éditions ACR.
(2) Marcel Duchamp, « À propos de moi-même », dans Duchamp du signe, Paris, Flammarion.
(3) Dans le sens premier, c’est à dire qui manifeste une prédominance d’idéalisme et de sentimentalité.
(4) L’art caché, Aude de Kerros, édition Eyrolles.
(5) À ne pas confondre avec le mouvement « art brut » mouvement se prônant indépendant de toute forme professionnelle du peintre Jean Dubuffet.
(6) Dans le sens kantien.
Préface de Vadim Korniloff, publié par les Edition du Canoë dans « À l’ouest le vent tourne » de Julian Semenov.
Préface
En rédigeant cette préface, je ne peux faire abstraction que je porte un nom russe qui témoigne de mes origines – mon père est russe, mon arrière-grand-mère ukrainienne – et que la littérature de ce pays est une de celles que je préfère et qui m’a nourri depuis l’enfance. Je ne peux pas faire abstraction non plus de la guerre qui se déroule actuellement entre la Russie et l’Ukraine et qui engendre en France et dans plusieurs pays d’Europe une agressivité vis-à-vis des Russes qui me trouble particulièrement.
Je suis artiste peintre, donc ni historien, ni politique mais curieux de l’histoire et de la politique à travers mes lectures qui irriguent mon travail plastique. La lecture de l’œuvre colossale de Semenov a été une découverte et un choc. Ses récits d’espionnage puisent dans l’une des périodes les plus passionnantes et complexes de l’Occident : de la naissance de l’URSS jusqu’au dénouement chaotique de la Deuxième Guerre mondiale. Il a créé un héros, Maxime Issaiev alias Max von Stierlitz, espion russe infiltré en Allemagne nazie au service des intérêts de son pays, dont on suit au fil des livres les aventures passionnantes.
Ce qui frappe en premier lieu, c’est la précision chirurgicale avec laquelle il structure ses romans à partir de faits historiques, dont la nature souvent spectaculaire et cachée interpelle le lecteur et l’invite à vérifier ce qu’il apprend. Dans À l’ouest, le vent tourne, on y découvre par exemple l’activité, et surtout le rôle pour le moins ambigu de l’industrie américaine, de ses services secrets et de certaines personnalités états-uniennes. On y croise, par exemple, de manière récurrente Allen Dulles, patron de l’OSS, ancêtre de la CIA, dont il deviendra le directeur après la guerre. Une simple recherche sur internet nous permet de savoir qu’il était aussi un avocat d’affaires représentant de grandes firmes industrielles et financières américaines en Allemagne qui entretenait des relations commerciales directes avec Gerhard Alois Westrick, avocat d’affaires allemand, – connu pour ses efforts à obtenir un soutien américain au gouvernement nazi. Il a défendu, entre autres, les intérêts d’ITT (International Telephone and Telegraph), une entreprise internationale américaine spécialisée dans les communications téléphoniques qui a fait l’objet d’une plainte en 1946, au nom du Ministère de la Justice américaine (Attorney General), pour « travail chez l’ennemi ou en territoire occupé par l’ennemi » (sic). La plainte est restée sans suite (1). Dans À l’ouest le vent tourne, le siège social d’ITT à Madrid est le lieu où Sierlitz toujours sous l’identité d’un Allemand ayant fait partie de l’état-major nazi, réchappé par miracle de la débâcle, est recruté.
L’après-guerre où se situe À l’ouest le vent tourne ouvre une nouvelle page dans l’histoire américaine. Roosevelt est mort et Truman, qui lui succède, met en action une politique qui désigne comme ennemi l’URSS et tous ceux, Américains ou Européens, trop à gauche qui ont combattu le nazisme. Les Allemands compromis avec le régime hitlérien sont recyclés lorsque leurs crimes ne sont pas trop voyants.
On l’aura compris, l’approche historique de Semenov se caractérise ainsi, par la volonté d’offrir à ses lecteurs le théâtre d’une réalité bien moins manichéenne que celle que nous avons l’habitude de lire ou d’entendre. Il est également notable de souligner qu’il ne fait jamais l’apologie de l’URSS ou de Staline. Par ailleurs, la grande majorité de ses personnages, dans la veine de ceux de Dostoïevski, sont souvent enclins à des tourments d’ordre existentiel. Ainsi, son héros, l’agent Stierlitz, à la différence de ceux de la littérature d’espionnage anglo-américaine, est incontestablement plus complexe, plus proche du Loup des steppes d’Hermann Hesse que de James Bond de Ian Flemming. C’est toujours le doute qui prédomine dans l’atmosphère oppressante de ses récits. La véracité des événements ainsi que la sincérité des individus que Stierlitz croise, amis comme ennemis, demeurent toujours comme suspendus, éloignés de toute vérité définitive. En lisant Semenov, l’on comprend que la “vérité historique” n’est au fond qu’une affaire très subjective qui dépend de l’appréciation fragile d’un fait, du témoignage d’un acteur ou d’une victime. Lewis Carroll nous a appris que dans un miroir, ce que l’on tient dans la main droite se trouve dans la main gauche, et cette vérité reflétée est tout aussi “véritable”, puisque c’est ainsi qu’on la voit (2).
« Le contraire de la vérité, du moins de son récit, est inéluctablement un mensonge. Cependant, le contraire de celui-ci n’est pas forcément la vérité ». Cette citation d’Hannah Arendt (3) pourrait résumer toute l’ambigüité que déploient les fils historiques et philosophiques des romans de Semenov, ainsi que le questionnement métaphysique de tous ses personnages, fictifs ou réels, qui luttent contre des forces extérieures invisibles. Ces forces, bien souvent, semblent les dépasser, voire parfois les engloutir. Dans La Taupe rouge, un épisode particulier incarne, à mon sens, cela. C’est celui dans lequel Stierlitz raconte à Käthe, autre agent russe infiltré en Allemagne nazie et visiblement proche du terme de sa grossesse, qu’un « vieux toubib (lui) a assuré qu’il se faisait fort de déterminer la nationalité de n’importe quelle femme au moment où elle accouche », car « elle crie toujours dans sa langue natale » (sic). Ainsi, Semenov nous rappelle combien l’adage philosophique spinozien se vérifie : les individus se trompent quand ils se croient libres, et donc en totale maîtrise et conscience de leurs actions et pensées, puisqu’ils ignorent les causes qui les déterminent.
Les aventures dans lesquelles Semenov nous invite, non seulement à la lecture, mais véritablement à l’immersion, m’ont fait resurgir à la mémoire un livre de Roland Gori (4), dans lequel il décortique les situations et mécanismes sociaux « extra-ordinaires » avec lesquels Stierlitz est aux prises. Ainsi Gori nous apprend que ce n’est pas tant la coercition subie par la population qui caractérise les pires sociétés totalitaires que l’absence de pensée qui résulte d’un certain confort dont jouit la dite population. On apprend également, entre autres, que le pourcentage de cas pathologiques chez les SS était le même que celui de la population générale. Ce qui a pu rendre possible l’absence d’empathie et de tout discernement tant moral qu’intellectuel chez ces individus, c’est la mise en place d’un dispositif qui impose et garantit une autonomie technique, et par voie de conséquence une solution technique totale. Cela permet ainsi aux acteurs des tragédies de ne pas penser. En quelques sorte, l’émergence du « pire » n’est possible que si la représentation d’une situation et de sa dynamique mortifère ne font pas l’objet d’un travail de pensée. Par ailleurs, croire que nous sommes aujourd’hui à l’abri du « pire », loin des paradigmes au parfum de fin du monde décrits par Semenov, est une hérésie. En effet, la pensée (l’action de (se) penser) ne s’est jamais autant asservie aux dispositifs et solutions techniques. Pendant le procès d’Eichmann à Jérusalem, Hannah Arendt rapporte que celui-ci objecta le fait qu’il avait obéi à des ordres, et qu’il s’était simplement soumis à la parole du Führer, c’est-à-dire à la loi de son pays. Comme le souligne Arendt, la validité d’une loi, contrairement à un ordre, n’est pas limitée dans le temps et l’espace. Aussi, les conséquences d’un ordre sont-elles ponctuelles et peuvent être ainsi jugées au regard d’une morale, de la loi. Mais quand les déviances d’une loi, donc d’un dispositif de règles juridiques et techniques qui supposent, dans un pays civilisé l’adhésion de la conscience, permettent qu’on dise par exemple : « Tu tueras », chacun se trouve fatalement dans la confusion de ce qui est condamnable ou pas, ou plus simplement de ce qui est bien ou mal (5). Ce questionnement, plus complexe que ce que nous renvoient nos systèmes d’information médiatiques actuels, fait partie intégrante, me semble-t-il, de l’œuvre de Julian Semenov.
Le 8 juin 1978, Alexandre Soljenitsyne a donné un discours d’une très grande intensité aux étudiants de l’université de Harvard. Ces derniers, et l’Amérique toute entière, ont été sidérés par la teneur de son discours. Soljenitsyne vivait aux États-Unis depuis plusieurs années, et le ton a été donné dès le début : « Non, je ne peux pas recommander votre société comme idéal pour la transformation de la nôtre (l’URSS). » Puis, il a ajouté : « Nous avions placé trop d’espoirs dans les transformations politico-sociales (occidentales), et il se révèle qu’on nous enlève ce que nous avons de plus précieux : notre vie intérieure. »
À la fin de la lecture d’un roman de Semenov, la conclusion du discours d’Harvard de Soljenitsyne me revient comme un coup de poing.
Lire Julian Semenov permet, je pense, de nous prémunir d’une certaine vision (historique) du monde, souvent pétrie d’un manichéisme délétère qui empêche toute pensée libre et réduit notre perception du réel à celui d’un narratif naïf, tel que l’industrie cinématographique hollywoodienne nous l’impose depuis sa naissance. Ce manichéisme systémique nous prive, lui aussi, d’une certaine manière, de l’un de nos biens les plus précieux : ce pari ambitieux des Lumières, celui de notre indépendance d’esprit, de notre liberté individuelle.
Alexandre Soljenitsyne a été étonné de l’accueil glacial retentissant que l’Occident a réservé à son discours. Il en a conclu que tout comme les dictatures, les démocraties (occidentales) avaient cette pathétique caractéristique commune : elles attendaient qu’on les flatte.
Vadim Korniloff
-
Pour plus d’informations sur ce sujet : Comment les firmes US ont travaillé pour le Reich, Pierre Abramovici, HISTORIA.
-
Alice au Pays des merveilles.
-
Eichmann à Jérusalem, Folio Histoire
-
Et si l’effondrement avait déjà eu lieu, aux éditions Les Liens Qui Libèrent, 2020, Roland Gori est professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l’université Aix-Marseille, auteurs de nombreux ouvrages.
-
« Dans le III° Reich, explique Hanah Arendt, le mal avait perdu cet attribut par lequel la plupart des gens le reconnaissent généralement – l’attribut de la transgression. » Puisque le mal était devenu de facto l’attribut du consentement à la loi. (Eichmann à Jérusalem, Folio Histoire)
.
————————————————————————————————-.
Article écrit par Vadim Korniloff sur le fondement de l’existence du centre d’art Pompidou Metz, publié dans le mensuel culturel « L’Estrade » n°82 (Mai 2018).

